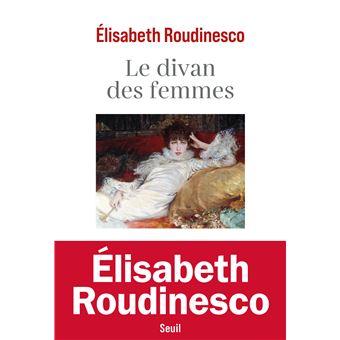Soutenez l'Appel des Appels
- De quoi la « dé-civilisation » est-elle le nom ? Un éloge réparateur et humaniste de la création envisagée en tant que lutte sociale et politique pour l’émancipation des êtres humains.
- Dans nos sociétés de contrôle, l’information est le moyen privilégié de surveiller, de normaliser et de donner des ordres. Les informations, molécules de la vie sociale, deviennent les sujets de...
- Il fallait à notre pays un certain culot pour élire à la magistrature suprême un jeune homme quasiment inconnu, négociateur habile du compromis autant que «traître» méthodique. Emmanuel Macron...
- Dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Ils naissent du vide culturel d’un monde politique sans esprit, d’un monde où les techniques sont devenues folles, d’un monde qui...
Les nouvelles de l'international
En réponse à une demande de Roland Gori, Laurence Branchereau et l'équipe de la Maison Saint-Jacques de Montréal nous ont envoyé le texte ci-joint que nous vous recommandons vivement à la lecture
Grève étudiante au Québec
La Maison St-Jacques, implantée à Montréal, est un organisme communautaire et alternatif en santé mentale qui est né au début des années ’70. Son mode de fonctionnement autonome et autogéré a permis au fil des années de modifier et de penser le cadre clinique qui est le sien. Son équipe composée de cliniciens issus de différents champs : psychologie, sociologie, littérature propose à des personnes de faible revenu, âgées entre 18 et 50 ans, une démarche de psychothérapie de groupe d’orientation psychanalytique.
L’équipe de la Maison St-Jacques, sensible à l’appel lancé par les étudiants québécois, se joint à de nombreuses voix qui les appuient en signant le texte qui suit. Il reprend les grandes lignes de ce mouvement étudiant gréviste qui a débuté en février 2012. Cette grève, qui perdure face à un gouvernement sourd à la parole de cette jeunesse, a été votée en opposition au modèle « utilisateur-payeur » visant à faire de l’éducation un bien de consommation individuel au détriment du collectif et de l’accès à l’éducation pour tous.
«Ras-le-bol des idées néolibérales!»
Ainsi titrait en première page dans son édition weekend du 26-27 mai, le journal Le Devoir, seul journal indépendant au Québec, qui s’est montré favorable, depuis le début, à la grève étudiante. Difficile de mieux résumer le vent politique qui souffle en ce moment sur le Québec et que le mouvement étudiant du «printemps-érable» aura déclenché.
Entrepris il y a plus d’une centaine de jours en réaction à l’annonce unilatérale du gouvernement du Premier ministre Charest d’augmenter de 75% les droits de scolarité des étudiants universitaires sur cinq ans, les votes de grève se sont multipliés dans de nombreuses facultés universitaires et plusieurs collèges d’enseignement public (CEGEP) sur tout le territoire québécois. Au bout de quelques semaines, le mouvement touchait plus de 200,000 étudiants soit près de la moitié des étudiants post-secondaires de tout le Québec.
Alors que le gouvernement a tenté de réduire les enjeux de cette grève à une affaire de «sous» («il faut bien que ces enfants gâtés qui, de toute façon, vont continuer à payer les frais de scolarité les plus bas en Amérique du Nord fassent leur «juste part»), les étudiants ont toujours associé leur revendication principale (gel des droits de scolarité, la hausse étant vue comme un pas en faveur de la marchandisation du savoir) à un débat de fond plus général sur le financement public des universités - ayant même fait des propositions précises à cet égard - sur le rôle et la place de l’enseignement supérieur dans notre société. Il se trouvait ainsi à renouer avec le consensus social qui avait vu le jour dans les années 60 autour de l’accessibilité du plus grand nombre de Québécois à l’enseignement supérieur, voire de la gratuité de l’enseignement universitaire.
Dans les premières semaines, le gouvernement Charest a laissé le conflit évoluer dans l’indifférence la plus totale, assuré que le mouvement s’essoufflerait de lui-même au bout de quelques semaines ou encore se dissoudrait sous la menace d’une annulation de la session académique en cours.
Bien mal lui en prit. Les étudiants, plus déterminés que jamais ont réitéré massivement, quelques semaines plus tard, dans leurs assemblées générales, les votes de prolongation de la grève au risque conscient d’y perdre leur session. Même des étudiants du secondaire, sous l’œil bienveillant de leurs professeurs et de certaines directions d’école, ont organisé des journées de débrayage et de soutien à leurs aînés.
Forcé de donner les apparences de vouloir négocier, après dix semaines de grève, le gouvernement a accepté, via sa ministre de l’éducation, de rencontrer les leaders étudiants, en précisant d’emblée que la question de «la hausse», au fondement de cette grève, ne serait pas discutée. Les leaders étudiants ont vite constaté que ces rencontres n’étaient que pure façade puisque le gouvernement n’avait rien à négocier! Suite à cette rencontre, les leaders étudiants ont soumis à la base étudiante les propositions du gouvernement. Elles ont été rejetées en bloc puisqu’elles ne touchaient aucunement au fond du problème : la hausse des frais de scolarité. Ces propositions n’ont fait qu’attiser la grogne et la détermination des grévistes.
Le mouvement a atteint une deuxième étape quand le conflit s’est judiciarisé. Des étudiants voulant continuer leurs cours ont demandé, au nom du droit à l’enseignement, des injonctions auprès de juges pour forcer le retrait des lignes piquetage afin de leur garantir l’accès à leurs cours. Les injonctions se sont multipliées dans différents collèges et facultés. Le gouvernement a fait pression auprès des institutions d’enseignement pour qu’elles fassent appliquer ces injonctions. Les étudiants grévistes, souvent avec le soutien des professeurs, se sont mobilisés davantage, ont résisté à l’anti-émeute et bloqué les entrées des institutions touchées par ces injonctions. Les directions des institutions concernées, à qui le gouvernement avait refilé les problèmes de «retour en classe», ont fini, devant le risque de violences encore plus grand, par abandonner leur tentative d’ouvrir les portes de leur collège et faculté, d’autant plus qu’une grande majorité de professeurs refusaient d’entrer donner leurs cours sous la pression policière et judiciaire et sont venus grossir les rangs des piqueteurs.
Autrement dit, non seulement les injonctions n’ont pas été respectées, au grand dam de la magistrature qui criait à la désobéissance civile, mais elles ont relancé la mobilisation étudiante.
La lutte a connu une autre étape lors d’une manifestation monstre et festive, appelée par les étudiants dans les rues de Montréal et quelques villes de province. A Montréal seulement, plus de 200,000 personnes ont marché le 22 mars (ça vous dit quelque chose?) dans les rues au son des tam-tam et autres tambours, déguisées, bariolées de couleurs où le rouge prédominait. Le mouvement de soutien s’est élargi : des groupes communautaires, syndicaux, de simples parents, des jeunes chômeurs, etc. ont marché aux côtés des étudiants. Un mois plus tard, une autre manifestation monstre, le 22 avril dernier, Jour de la Terre, a regroupé en plus des étudiants et des groupes ci-haut mentionnés, de nombreux artistes progressistes et des écologistes pour constituer à la fin de la marche et du spectacle musical, un gigantesque arbre de 250,000 personnes!
L’indifférence du gouvernement, qui ne bronchait toujours pas d’un iota sur ses positions, a alimenté la lassitude et la frustration des étudiants dont une partie plus radicale a décidé d’organiser en petits groupes mobiles des manifestations nocturnes, sorte de guérilla urbaine nouvelle manière. A ce jour, plus d’une trentaine de marches de ce genre regroupant de 500 à 10,000 jeunes par soir, parfois dans des manifestations simultanées différentes dans divers quartiers de la ville, se sont mises en branle à la tombée de la nuit. L’anti-émeute lourdement équipée, harassée par des étudiants plus jeunes et plus rapides qui changeaient de trajets au dernier moment, qui se dispersaient soudain pour réapparaître à nouveau quelques rues plus loin, multipliait avec d’autant plus d’agressivité, les arrestations et les coups de matraques qui pouvaient frapper quiconque se retrouvait par hasard sur la rue à ce moment-là. Rien n’y a fait. Les étudiants sont revenus soir après soir.
Le gouvernement et certains médias ont bien tenté d’isoler ce mouvement en traitant ces jeunes de «casseurs» et en l’associant au regroupement de grévistes étudiants le plus radical, la Classé. Mais la tentative de division n’a pas fonctionné, les associations étudiantes sont restées solidaires et ont maintenu leur front commun. Impuissante, la ministre de l’éducation a démissionné… Tandis que le corps policier se plaignait publiquement de «fatigue» et de «surcharge» de travail. Taper sur de l’étudiant un soir, deux soirs, ça va mais quinze, vingt fois, ça épuise!
Dernier grand coup du gouvernement Charest, la loi «spéciale» 78 improvisée de toute évidence dans la panique. Entre autres, cette loi suspend tout droit de manifester à moins d’avertir les autorités policières 8 heures à l’avance du trajet de la manifestation, interdit tout attroupement à moins de 50 mètres de toute institution scolaire, menace d’amendes «salées» les associations étudiantes et les organisateurs de manifestations qui ne se conforment pas à ce diktat et donne plein droit aux corps policiers (les policiers de Montréal, épuisés de leurs chasse nocturnes aux étudiants, ont fait appel à leurs confrères de la Sûreté du Québec) de décider du moment où une manifestation de légale, devient illégale et donc de la disperser… par le moyen «légal» dont ils disposent : la force.
Encore une fois, loin de faire taire les étudiants, cette loi les a galvanisés : non seulement les manifestations de nuit n’ont pas cessé, une autre manifestation monstre de 250,000 personnes s’est tenue dans les rues de Montréal le 22 mai dernier. Si le trajet était connu des policiers, des pans entiers de la manifestation ont pris des directions improvisées avant d’aboutir à la destination prévue sous le regard impuissant des policiers.
Le mouvement s’est élargi encore davantage avec l’apparition quelques jours plus tard d’un autre moyen d’action. Depuis presque deux semaines, en début de soirée, un tintamarre de casseroles et de tambours se fait entendre en appui aux étudiants. Apparu dans certains quartiers du centre de Montréal, le mouvement s’est rapidement étendu en périphérie jusque dans des villes de banlieue et de province. Manifestations festives, carnavalesques qui rapprochent les gens dans les quartiers, créent des complicités improbables autrement, et surtout témoignent de l’écœurement d’une population face à un gouvernement qui a laissé sa jeunesse scolarisée dans la rue depuis des mois et provoqué un gâchis financier et administratif qu’on mettra longtemps à réparer.
Au moment où on rédige ce texte, la nouvelle ministre de l’éducation, (après la matraque totalement inutile, la carotte?) a réaffirmé son intention de renégocier «de bonne foi» avec les leaders étudiants… Nous en sommes là!
De toute évidence, si l’élément déclencheur du mouvement de contestation a été la hausse des droits de scolarité, bien d’autres enjeux sont rapidement venus s’y greffer : les salaires mirobolants versés à certains recteurs d’université qui ont fait la manchette en février dernier, le greffage de plus en plus étroit des instituts de recherches universitaires aux conglomérats industriels qui ont tendance en échange à les financer, dénoncé par de plus en plus d’universitaires ; les bonus accordés à certains chefs d’entreprise et hauts dirigeants des grandes banques au lendemain d’une des pires crises du capitalisme qui a jeté des millions de personnes dans la rue ; la corruption éhontée dans l’industrie de la construction, connue de tous, à laquelle certains membres influents du parti libéral au pouvoir depuis près de 10 ans sont soupçonnés d’être mêlés (l’ex-bras- droit du maire de Montréal, lui-même ancien libéral, a été arrêté sous accusation de corruption), le laisser-faire du gouvernement dans la prospection du gaz de schiste par des compagnies privées étrangères qui débarquent sans s’annoncer dans la cour des gens; le bradage de nos ressources naturelles dans le Grand Nord craint par plusieurs scientifiques et les menaces à l’éco-système de la forêt boréale qui inquiètent de nombreuses populations autochtones. On comprend que le Plan Nord, tant vanté par Charest et élaboré sans consultation publique, soit dans la mire critique de nombreux québécois par les temps qui courent.
Un journaliste du Devoir voit dans les stratégies du gouvernement Charest une tentative de «canadianiser» le mouvement étudiant québécois en le comparant constamment au modèle anglo-saxon de financement des institutions universitaires. Par ailleurs la loi 78, en judiciarisant tout conflit collectif à l’intérieur de ces mêmes institutions, au nom du droit «contractuel» des individus inscrits dans les dites institutions, subordonne les droits collectifs aux droits individuels. Ce coup de force de droite, digne du gouvernement conservateur Harper, permet à n’importe quel individu d’entreprendre un recours contre un professeur, un étudiant, un syndicat ou toute personne qui retarderait ou empêcherait la reprise et le maintien des cours dans le cadre d’un conflit collectif et ce, dans le mépris le plus grossier du droit d’association pourtant garanti par les chartes québécoises.
Quand à cette jeunesse étudiante qualifiée si souvent d’«enfants-rois», de privilégiés qui vivraient au crochet de la société et que l’on croyait endormie, a-politique, préoccupée essentiellement à s’amuser sur les jeux vidéos et à polir son image facebook, force est de constater que tout le monde s’est trompé. Et si c’est le contraire qui était vrai se demande le journaliste du Devoir Christian Rioux, si l’étudiant n’était pas en effet «un des derniers citoyens à sacrifier un avantage immédiat, celui d’un salaire, et tout ce qu’il procure, pour faire le choix du savoir?» Par ailleurs un sociologue québécois déclarait dans les pages du même journal : «Première génération numérique, ils (les étudiants) font actuellement la démonstration que cette forme de parcours, tourné sur soi, ne les empêche pas de se montrer très solidaires au besoin grâce, notamment, aux médias sociaux».
Gabriel Nadeau-Dubois, porte parole de l’association étudiante la plus radicale, disait la semaine dernière : «Après quatre, cinq, six semaines de grève (…) il y a eu un bouillonnement d’idées. Cette conjonction de ces gens très nombreux qui n’ont rien à faire de leur vie, sauf de parler politique, de participer à des actions et à des manifestations, ça crée un climat de changement social». Un organisateur du même syndicat d’ajouter : «Après plus de deux mois de grève, ils (les étudiants) réalisent que les droits de scolarité c’est la pointe de l’iceberg, de l’iceberg néo-libéral».
- Albert Ciccone est professeur émérite de psychopathologie et psychologie clinique (université Lumière-Lyon 2), psychologue, psychanalyste, président de la Convergence des Psychologues en Lutte (CPL) et de l’Association Lyonnaise pour une Psychanalyse À partir...
- Alors que la presse générale n'a de cesse de concentrer ses analyses sur la question du nombre trop important de fonctionnaires ou l'efficacité du service public, à la faveur des échéances électorales, Christelle Mazza décrit, sans filtre, les...
- À paraître le 06/03/2026 Rencontre à la librairie Compagnie (Paris), à 20h, avec Elisabeth Roudonesco autour de son livre, Le Divan des femmes.
- Jeudi 19 février 20h30 au ciéman Les Trois Luxembourg Séance spéciale du film ROLAND GORI, UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT de Xavier Gayan, en présence de Roland Gori, Alian Vanier et Xavier Gayan Plus d'information sur le site des Trois Luxembourg
- Par Roland Gori, article paru dans le journal l'humanité du 22 février 2012
- Emission de Catherine Parisot sur Fréquence protestante avec Roland Gori, psychanalyste : "Contre la tyrannie des experts : la liberté de penser"
- On a beaucoup parlé cette semaine d'agences de notation, de dégradation de notes, de crise de l'Europe et ...de gros sous. Mais comment construire un monde différent, comment le penser quand les chiffres et les notations nous imposent leur loi... Une...
Copyright © 2011 L'Appel des appels | Tous droits réservés - Contact