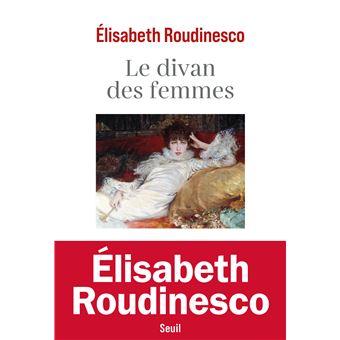Soutenez l'Appel des Appels
- De quoi la « dé-civilisation » est-elle le nom ? Un éloge réparateur et humaniste de la création envisagée en tant que lutte sociale et politique pour l’émancipation des êtres humains.
- Dans nos sociétés de contrôle, l’information est le moyen privilégié de surveiller, de normaliser et de donner des ordres. Les informations, molécules de la vie sociale, deviennent les sujets de...
- Il fallait à notre pays un certain culot pour élire à la magistrature suprême un jeune homme quasiment inconnu, négociateur habile du compromis autant que «traître» méthodique. Emmanuel Macron...
- Dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Ils naissent du vide culturel d’un monde politique sans esprit, d’un monde où les techniques sont devenues folles, d’un monde qui...
Le nouveau totalitarisme culturel de la pensée simplificatrice
Article paru dans le journal l'humanité du 22 février 2012
Par Roland Gori, Professeur émérite de Psychopathologie clinique à l’Université d’Aix-Marseille (*).
L’autisme a reçu le label « grande cause nationale » cette année. À cette occasion, des associations de parents d’enfants atteints d’autisme exigent la fin de l’approche psychanalytique dans sa prise en charge en France au profit de méthodes comportementalistes (ABA, Teach…). Le dépôt d’une proposition de loi, le 20 janvier 2012, par le député UMP Daniel Fasquelle, professeur de droit, particulièrement investi dans les questions de pêche, de chasse et d’aménagement du territoire, va dans le même sens : interdire les pratiques, les recherches et les enseignements psychanalytiques dans l’accompagnement des personnes autistes. Les pratiques de soin ne se « calibrent » pas aussi facilement que la taille des saumons dont on autorise la pêche…
Pour imposer une normalisation des pratiques, notre société s’appuie sur un double dispositif de légitimation, celui des agences d’expertise et d’évaluation et celui des fabriques de l’opinion publique soumises à l’intense lobbying des protagonistes. La récente publication dans Libération d’un extrait du rapport de la Haute Autorité de santé (HAS) à paraître en mars prochain et censé exclure l’orientation psychanalytique dans l’autisme conduit à une véritable « bataille rangée » sur la scène médiatico-politique malgré le communiqué de la HAS, regrettant cette publication « inexacte et hors contexte ». La guerre est déclarée entre deux camps. Les uns arguent de leurs expériences cliniques et de leurs valeurs humanistes, les autres évoquent des « évaluations internationales » (ce qui veut dire anglo-saxonnes).
Et c’est bien à une nouvelle forme de judiciarisation des débats, des savoirs et des pratiques que nous avons à faire. Violemment. Celui qui parvient à prescrire les normes et le « calibrage » de ce qui peut socialement être admis, en fabriquant les émotions de l’opinion publique, en mobilisant à son avantage les passions politiques, en s’appuyant sur des « experts » avec lesquels il entretient quelques affinités, finit par emporter le « marché ». Il faut le répéter, dans le domaine de la santé mentale, le « marché » est d’autant plus « juteux » et infini que le périmètre de ses objets est instable, ses « critères » imprécis, ses « méthodes », ses « pratiques » et ses « savoirs » incertains, mal assurés. Paradoxalement, la complexité scientifique des problèmes de santé mentale invite à leur « simplification », les expose aux modes et aux idéologies.
L’urgence, c’est tout de même de poser des questions avant de s’engouffrer dans des réponses. Pour exemples : la « santé mentale » relève-t-elle du seul champ de la médecine ? La schizophrénie peut-elle vraiment être dépistée comme le diabète ? Est-il légitime qu’après des décennies d’idéologie psychanalytique, quelquefois outrancière, ce soit aujourd’hui l’idéologie médico-biologique qui recompose l’ensemble des savoirs, des pratiques et des formations de ceux qui prennent en charge les souffrances psychiques et sociales ? Peut-on distinguer la rationalité scientifique d’un savoir ou d’une méthode et l’idéologie qu’elle favorise comme les discours politiques qui s’en emparent ? Sommes-nous capables d’une confrontation et d’un débat épistémologique autant que démocratique entre praticiens et chercheurs en s’abstenant de stigmatiser ou de détruire (symboliquement mais parfois aussi matériellement) le « différend », comme l’y invite aujourd’hui la culture des « marchés » ? Sommes-nous capables de trouver d’autres manières d’« évaluer » que celles qui prolifèrent avec la « bureaucratie » des expertises, leurs dispositifs de certification conforme et inerte, ou encore les « conflits d’intérêts » qui planent parfois sur les membres des commissions ? Peut-on éviter que des décisions hâtives soient prises qui « embolisent » le récit et la transmission d’expériences innovantes au nom de la conformité, laquelle n’est bien souvent que le masque du conformisme ? Sait-on que certaines méthodes et évaluations thérapeutiques dont on chante les louanges sont actuellement remises en cause par des travaux plus récents ? Est-ce parce qu’un cancer se révèle d’origine génétique, virale ou environnementale que sa prise en charge doit exclure le soin psychique ?
Il n’est jamais très sain que le politique inscrive dans le marbre de la loi une vérité scientifique qui, par nature, se révèle incertaine et temporelle.
Au moment où le politique tend à faire son marché auprès des « experts » et des « savoirs » transformés en magasins en libre-service afin de pallier la crise de leur autorité, il serait dommageable que les « travailleurs de la preuve » laissent ces passions politiques confisquer leurs débats et régler leurs différends. C’est avec les patients et leurs familles, qui possèdent aussi un « savoir expert », existentiel, qu’en matière thérapeutique nos savoirs et nos méthodes se doivent d’évoluer sans que pour autant leur judiciarisation s’installe en lieu et place du débat.
Déjà, quelques déclarations fracassantes et provocatrices annoncent une campagne électorale aux allures de « guerre civile ». Il conviendrait d’éviter qu’un tel climat s’étende aux champs de la recherche, du soin et de la justice. Ce ne serait bon ni pour le soin, ni pour la recherche, ni pour la justice, ni même pour la démocratie. Faute de quoi, un nouveau totalitarisme culturel s’installerait, celui de la pensée simplificatrice qui ferait, comme l’écrivait Lévi-Strauss que : « L’humanité s’installe dans la monoculture ; elle s’apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat. » (Tristes Tropiques, 1955, Paris, Plon, p. 39.)
(*) Dernier ouvrage paru : la Dignité de penser, éditions LLL, 2011.
Roland Gori
- Albert Ciccone est professeur émérite de psychopathologie et psychologie clinique (université Lumière-Lyon 2), psychologue, psychanalyste, président de la Convergence des Psychologues en Lutte (CPL) et de l’Association Lyonnaise pour une Psychanalyse À partir...
- Alors que la presse générale n'a de cesse de concentrer ses analyses sur la question du nombre trop important de fonctionnaires ou l'efficacité du service public, à la faveur des échéances électorales, Christelle Mazza décrit, sans filtre, les...
- À paraître le 06/03/2026 Rencontre à la librairie Compagnie (Paris), à 20h, avec Elisabeth Roudonesco autour de son livre, Le Divan des femmes.
- Jeudi 19 février 20h30 au ciéman Les Trois Luxembourg Séance spéciale du film ROLAND GORI, UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT de Xavier Gayan, en présence de Roland Gori, Alian Vanier et Xavier Gayan Plus d'information sur le site des Trois Luxembourg
- A lire sur Mediapart. Après quatre mois de grève, le mouvement étudiant s’est transformé. Avant la rentrée universitaire de la mi-août, ses animateurs veulent mobiliser tout l'été. Et il est de plus en plus question d'élections anticipées...
- Par PIERRE JOLY Psychothérapeute à la Maison Saint-Jacques, Montréal Article paru dans Libération du 11 juin. Les étudiants québécois s’opposent au gouvernement libéral de Jean Charest qui a décrété une hausse de 75% (en cinq ans) des...
Le nouveau monde et la crise des valeurs. Manifeste de soutien aux étudiants et collègues québécois.
Pour les plus anciens d’entre nous, l’insurrection étudiante au Québec réveille de bien vieux souvenirs. Comparaison n’est pas raison. Il n’empêche.
Copyright © 2011 L'Appel des appels | Tous droits réservés - Contact