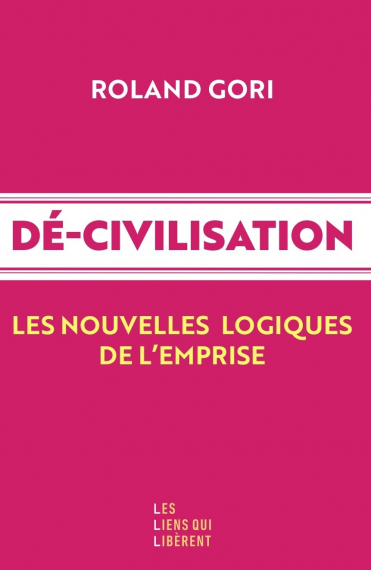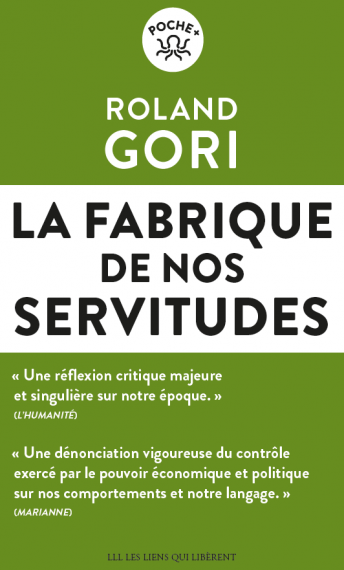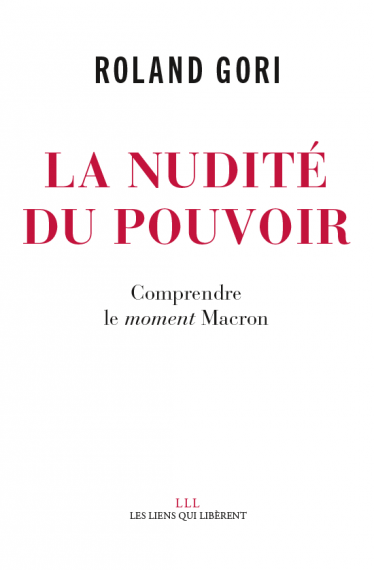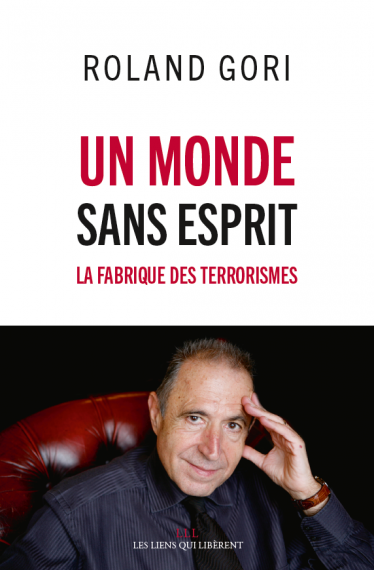Soutenez l'Appel des Appels
- De quoi la « dé-civilisation » est-elle le nom ? Un éloge réparateur et humaniste de la création envisagée en tant que lutte sociale et politique pour l’émancipation des êtres humains.
- Dans nos sociétés de contrôle, l’information est le moyen privilégié de surveiller, de normaliser et de donner des ordres. Les informations, molécules de la vie sociale, deviennent les sujets de...
- Il fallait à notre pays un certain culot pour élire à la magistrature suprême un jeune homme quasiment inconnu, négociateur habile du compromis autant que «traître» méthodique. Emmanuel Macron...
- Dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Ils naissent du vide culturel d’un monde politique sans esprit, d’un monde où les techniques sont devenues folles, d’un monde qui...
ROBERT BADINTER « Un intellectuel en politique »
Robert BADINTER nous a quittés. Rares sont ceux, qui comme lui, laissent une trace indélébile dans l’histoire de son pays, et même au-delà de ses frontières. Robert BADINTER en fait partie. Rares sont ceux qui, au-delà de leur mort, inspirent les nouvelles générations. Robert BADINTER est de ceux-là.
Il a été l’homme, l’avocat, le ministre qui a accompagné et nourri des générations de magistrats, dont je fais partie, et plus largement de juristes. Il continue à l’être pour les nouvelles générations, dont l’une des promotions de l’École nationale de la magistrature s’est donné son nom.
Il a été l’un des plus grands ministres de la justice qu’a connus la France, grand réformateur, transformateur de la justice, inlassable défenseur des droits de l’homme jusqu’à ses derniers instants, constant dans la promotion d’une justice indépendante nationale comme internationale.
Il a aussi pu mener et gagner ces combats, parce qu’il était irréprochable, avec sa droiture, son honnêteté intellectuelle, sa justesse d’esprit. Son intelligence, son humanisme, son attention à l’autre, sa curiosité, son éloquence au service de la force de ses convictions ne pouvaient qu’emporter l’adhésion de ses interlocuteurs.
J’ai eu l’immense privilège, le bonheur, l’honneur d’avoir pu rencontrer Robert BADINTER et échanger avec lui, en plusieurs occasions et notamment en 3 qualités, Président de la Conférence Nationale des Procureurs de la République (CNPR) sur le statut du parquet et l’indépendance de la justice, membre du cabinet de Lionel Jospin à l’occasion du 50 éme anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et de la création de la Cour pénale internationale CPI, Directeur des affaires criminelles et des grâces enfin, sur le parquet européen.
*********
Les lois votées sous l’impulsion de Robert BADINTER étaient « révolutionnaires » dans le contexte de l’époque : suppression de la peine de mort, du délit d’homosexualité, des juridictions d’exception. Mais toutes les réformes qu’il a soutenues, et toutes les prises de position, qu’il a exprimées tout au long de sa vie, se sont inscrites dans une vision globale et constante de l’humanité et de la société, fondée sur des valeurs et des convictions.
Le respect de la dignité humaine.
Convaincu de la nécessité d’ « une prison qui ne soit ni inhumaine ni infantilisante, qui ne secrète pas la désocialisation », il a bouleversé les conditions de détention : suppression des quartiers de haute sécurité, instauration de parloirs libres – sans séparation ni hygiaphone –, autorisation des appels téléphoniques à la famille une fois par semaine, suppression du costume pénitentiaire et installation de télévisions dans les cellules. Il a instauré les Travaux d’intérêt général (TIG) comme alternatives aux courtes peines. Et jusqu’à la fin de sa vie, il n’aura de cesse de dénoncer la surpopulation carcérale qui ne permet pas d’assurer le respect de l'intimité, de la dignité des détenus ni de préparer la réinsertion dans une telle promiscuité.
La reconnaissance de la souffrance des victimes.
S’il a amélioré les conditions de détention, Robert Badinter a aussi fait avancer les droits et la défense des victimes, en faisant adopter des dispositions en faveur des victimes d’accident de la route et des victimes d’attentats ainsi que, de façon concrète, en accordant des subventions aux associations d’aide aux victimes, en impulsant dès 1982, le réseau des professionnels de l'aide aux victimes sous la bannière de l’INAVEM (Institut National de l’Aide aux Victimes et à la Médiation).
La défense des droits de l’homme, le combat d’une vie.
Dès octobre 1981, avec la ratification de l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme, article accordant le droit de requête individuel des particuliers à l'encontre de l’État français, la France devient enfin partie intégrante de la Convention, près d’un quart de siècle après la création de la Cour européenne des droits de l’homme. A chaque anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à chaque manifestation de promotion des valeurs humanistes, il répondait présent. Il répétait la force du message de la Déclaration universelle, qui s’est construit sur le refus du racisme, et de toute discrimination, expression du mépris et de la haine de l’autre. Avec la même verve, il soutenait l’universalisme mais mesurait les dangers qui le menaçait face aux « différentialistes » ou « multiculturalistes », « pour lesquels chaque État est souverain et libre d’interpréter les droits de l’homme et de les mettre en œuvre à sa manière, et face à ceux qui « considèrent les droits de l'homme comme un don de Dieu, qu'il convient par conséquent d'interpréter à la lumière de la charia, en excluant de fait les juristes au profit des docteurs en théologie ».
Le refus d’une politique pénale sécuritaire
Dénonçant l’aberration de l'accélération de l'inflation législative répressive, souvent justifiée par l’émotion suivant un fait divers, il s’est opposé à la banalisation des lois d’exception et des mesures de sûreté. Rappelant qu’un mineur est un être en devenir, il a toujours soutenu la nécessité absolue de conserver la philosophie de l'ordonnance de 1945, d'abord et toujours éduquer, former, prévenir et réinsérer. Il n’était pas concevable pour lui de remettre en cause les principes de l'État de droit, par des mesures politiquement exploitables, ni de refuser la possibilité de rédemption des hommes et des femmes, ni d’aggraver les inégalités sociales en surveillant et punissant, plus que les autres, les plus défavorisés au prétexte de leur dangerosité présumée.
L’indépendance de la justice
Il n’a eu de cesse de défendre l’indépendance de la justice, pilier de l’État de droit, mais aussi les magistrats dont il saluait régulièrement l’intégrité.
Il s’est opposé au projet de suppression du juge d’instruction lancé par Nicolas Sarkozy en 2009, parce qu’il revenait à confier l’instruction aux procureurs sans remettre en cause leur statut et en les laissant sous la dépendance du pouvoir exécutif, et qu’il aboutissait à renforcer l’emprise du pouvoir politique sur la justice pénale.
A propos du parquet et à l’occasion de ce projet, il disait : « Il faut assurer aux procureurs des garanties d'indépendance qui mettent leur carrière et leur régime disciplinaire au même niveau que les juges. Sinon, vous aurez inévitablement le soupçon, et parfois l'effectivité, d'un pouvoir politique dirigeant la marche des instructions à travers le parquet, même sous le contrôle d'un juge ». Cela est d’autant plus juste aujourd’hui, au moment où 95% des enquêtes sont menées sous la direction des parquets, et où la procédure pénale accroit constamment leurs pouvoirs.
La promotion d’une justice internationale
Convaincu qu’en privilégiant la voie du droit plutôt que celle de la vengeance pour juger les responsables nazis, les initiateurs du Tribunal de Nuremberg avait fait le bon choix, - « car il ne peut y avoir de paix durable sans justice » -, Robert Badinter n’a cessé de plaider pour l’instauration d’une cour pénale internationale. Il a pesé de tout son poids pour que la France soutienne cette idée. Après l’adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998, il s’est lancé dans une tournée européenne, afin de convaincre les pays qui ne l’avaient pas encore signé de le faire. Même s’il avait conscience des limites du règlement de la cour adopté, Robert Badinter était toujours capable d’accepter et de promouvoir le compromis qui permet de faire progresser une cause. Et c’était pour lui une importante cause, celle qui rendait possible de juger les auteurs de crimes contre l’humanité. Son dernier combat juridique a été son engagement en faveur du jugement de Vladimir Poutine pour les crimes commis lors de la guerre en Ukraine, dans un ouvrage intitulé : « Vladimir Poutine, L’accusation » co-écrit avec Bruno Cotte et Alain Pellet, qui propose une analyse rigoureuse et documentée des crimes reprochés au président russe.
Profondément européen, il a contribué à la création d’un parquet européen apte à diriger les poursuites dans toutes les nations de l’Union européenne. Il a même plaidé devant la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée Nationale pour étendre sa compétence à la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière, « précisément parce que le crime lui, est transfrontalier, dans toutes ses manifestations les plus redoutables, et que la poursuite des criminels doit être pilotée par un parquet européen », propos qui résonnent avec une particulière actualité au moment où la France fait au contraire le choix d’une réponse nationale.
********
Plus que jamais, alors que l’état de droit est remis en cause, que les juges sont attaqués, que les théories des sombres lumières se développent au niveau mondial, le rappel inlassable de la parole de Robert Badinter est nécessaire.
Il a porté constamment les valeurs universalistes, républicaines et les a traduites en politique, Il a été, comme il qualifiait Condorcet dans un livre remarquable écrit avec son épouse Elisabeth, « un intellectuel en politique ». Les réalisations qu’il a pu mener ont été possibles aussi grâce à l’adhésion et l’engagement d’une gauche humaniste, républicaine et européenne que représente le parti qui a été le sien le Parti Socialiste. Il revient à ce parti, fort de son histoire et de sa capacité à mener à bien des réformes, de défendre et de poursuivre l’œuvre et la pensée de Robert Badinter.
L’hommage rendu à ce grand homme en lui ouvrant les portes du Panthéon est un moment important, qui manifeste l’attachement de la France à ce qu’il représente. Mais il faut rester lucide car certains de ceux qui lui rendent hommage, qui se réclament de sa pensée, peuvent être prêts par pure tactique politicienne, à transiger sur les libertés et la dignité humaine et à s’allier avec ceux qui ont toujours affronté Robert Badinter et combattu ses idées.
Mais ne retenons aujourd’hui qu’une chose : Avec Condorcet, Zola, Hugo il rejoint le Panthéon et va y retrouver Jaurès.
Robert GELLI
Magistrat honoraire
- A lire sur Mediapart. Après quatre mois de grève, le mouvement étudiant s’est transformé. Avant la rentrée universitaire de la mi-août, ses animateurs veulent mobiliser tout l'été. Et il est de plus en plus question d'élections anticipées...
- Par PIERRE JOLY Psychothérapeute à la Maison Saint-Jacques, Montréal Article paru dans Libération du 11 juin. Les étudiants québécois s’opposent au gouvernement libéral de Jean Charest qui a décrété une hausse de 75% (en cinq ans) des...
Le nouveau monde et la crise des valeurs. Manifeste de soutien aux étudiants et collègues québécois.
Pour les plus anciens d’entre nous, l’insurrection étudiante au Québec réveille de bien vieux souvenirs. Comparaison n’est pas raison. Il n’empêche.
Par Roland Gori, à lire dans Libération
- Par Roland Gori, article paru dans le journal l'humanité du 22 février 2012
- Emission de Catherine Parisot sur Fréquence protestante avec Roland Gori, psychanalyste : "Contre la tyrannie des experts : la liberté de penser"
- On a beaucoup parlé cette semaine d'agences de notation, de dégradation de notes, de crise de l'Europe et ...de gros sous. Mais comment construire un monde différent, comment le penser quand les chiffres et les notations nous imposent leur loi... Une...
Copyright © 2011 L'Appel des appels | Tous droits réservés - Contact