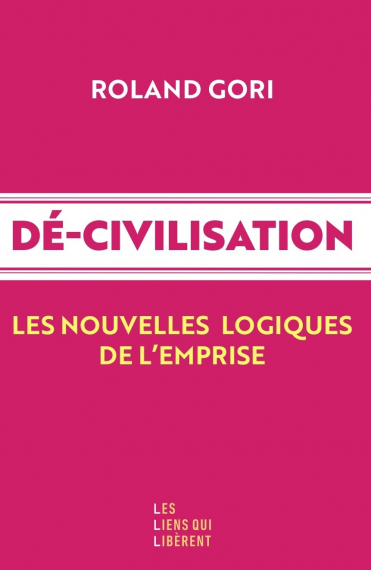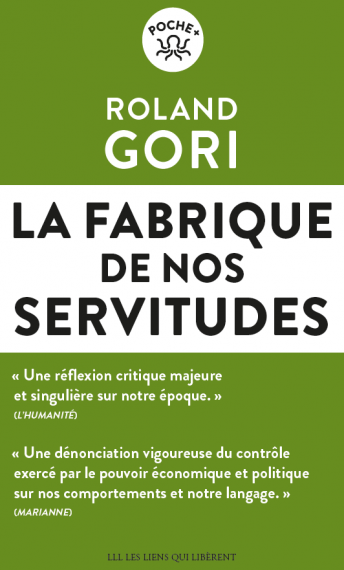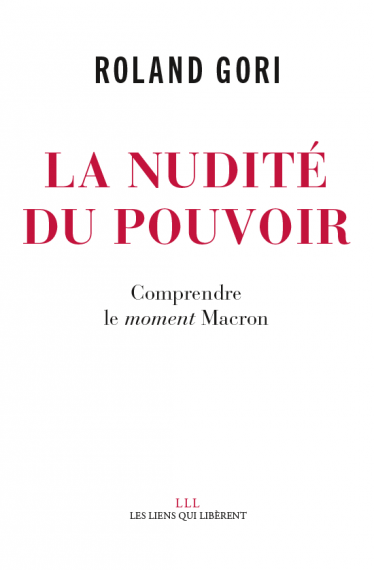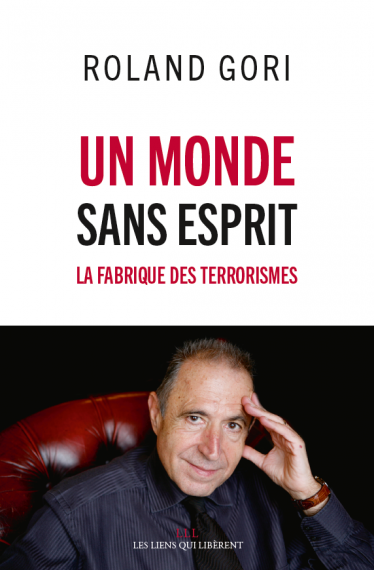Soutenez l'Appel des Appels
- De quoi la « dé-civilisation » est-elle le nom ? Un éloge réparateur et humaniste de la création envisagée en tant que lutte sociale et politique pour l’émancipation des êtres humains.
- Dans nos sociétés de contrôle, l’information est le moyen privilégié de surveiller, de normaliser et de donner des ordres. Les informations, molécules de la vie sociale, deviennent les sujets de...
- Il fallait à notre pays un certain culot pour élire à la magistrature suprême un jeune homme quasiment inconnu, négociateur habile du compromis autant que «traître» méthodique. Emmanuel Macron...
- Dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Ils naissent du vide culturel d’un monde politique sans esprit, d’un monde où les techniques sont devenues folles, d’un monde qui...
Entretien avec le psychanalyste, Roland Gori
Entretien réalisé par Jeanne de Gliniasty, et consultable ici.
Roland Gori est professeur honoraire de psychopathologie clinique à l’Université d’Aix-Marseille, psychanalyste, membre d’Espace analytique. Il est également l’initiateur de l’Appel des Appels, un collectif constitué en 2009 « pour résister à la destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien social »1. Il est aujourd’hui l’actuel Président de l’Association Appel des Appels.
2Roland Gori est en outre l’auteur de nombreux essais dont La fabrique des imposteurs (LLL, 2013), La santé totalitaire. Essai sur la médicalisation de l’existence (avec Marie-José Del Volgo, Champs Flammarion, 2014), L’individu ingouvernable (LLL, 2015), Un monde sans esprit (LLL, 2017), La nudité du pouvoir. Comprendre le moment Macron (LLL, 2018), La fabrique de nos servitudes (LLL, 2023). Son dernier ouvrage Dé-civilisation. Les nouvelles logiques de l’emprise (LLL, 2025) offre, dans la lignée des précédents, une photographie saillante de notre civilisation et du malaise qu’elle traverse. En tant qu’elle est celle d’un psychanalyste et essayiste, mais plus encore celle d’un humaniste de notre siècle, la pensée de Roland Gori intéressera les lecteurs de la Revue.
Dans Malaise dans la civilisation qu’il écrit dans l’entre-deux guerres (publié pour la première fois en 1930), Freud met en lumière l’ambivalence intrinsèque de la civilisation qui, ayant pour condition la répression des pulsions agressives, se réalise par l’intériorisation de ces pulsions par les individus eux-mêmes. Plus d’un siècle plus tard, l’État de droit fait l’objet d’attaques de plus en plus assumées, notamment de la part de ceux qui nous gouvernent2. Comment expliquer cette banalisation des coups portés à l’ordre politique et juridique au fondement de notre démocratie occidentale ? Est-ce l’un des symptômes d’une Dé-civilisation, pour reprendre le titre de votre nouveau livre ?
Sigmund Freud avait insisté sur le point que vous venez évoquer : les restrictions imposées par les civilisations mobilisent chez les individus une forte ambivalence. Ils les aiment pour les violences qu’elles leur évitent de subir et les détestent pour les sacrifices qu’elles leur imposent. Le renoncement à l’agression et à l’exploitation des autres auquel la civilisation contraint les individus, les rassure et congédie leur peur (de mourir). Mais, en même temps, ce sacrifice des désirs pulsionnels, agressifs et sexuels, mobilise leur sourde hostilité puisqu’il les contraint à s’auto-contrôler. Cette pulsion agressive, dérivée de l’instinct de mort, trouve en certaines occasions comme la guerre ou les violences sociales, l’occasion de se manifester plus ouvertement. L’intériorisation des interdits de tuer demeure à géométrie variable. Tout dépend de l’époque et des mœurs de la société dans laquelle vivent les humains.
Ce sont précisément ces caractères de contrainte et d’inhibition des pulsions selon les époques et les sociétés qui m’intéressent et dont je trouve des éléments de réponse dans les travaux de Norbert Élias. Les travaux de Norbert Élias3 inspirent depuis presque vingt ans4 mes propres recherches dans la mesure où ce sociologue s’est toujours refusé à séparer la psychogenèse et la sociogenèse.
Pour comprendre ces notions de civilisation etde dé-civilisation, il me faut rappeler que pour Norbert Élias, les processus de civilisation consistent, tout au long de l’histoire occidentale, dans une individualisation des contraintes sociales conduisant l’individu à s’auto-contrôler et à refouler lui-même ses pulsions, c’est-à-dire à s’interdire ce qu’auparavant les contrôles exogènes de la société lui interdisaient. Norbert Elias situe le relâchement des inhibitions et des autocontrôles des comportements dans un contexte historique et politique particulier. A contrario des autres États européens, l’unification de l’Allemagne fut tardive et instable ; résultant de la victoire de 1870-1871 sur la France, elle y est parvenue à l’ombre des canons aristocratiques et guerriers de la civilisation de cour. A contrario de la France et de l’Angleterre où la « bonne société » bourgeoise des capitales définissait les nouveaux « canons de comportements », en Allemagne les fonctions sociales d’intégration et de régulation étaient assurées par des institutions plus anciennes et délocalisées, comme l’armée, les associations étudiantes combatives et les grandes familles aristocratiques qui monopolisaient les postes politiques et administratifs décisionnels. Norbert Élias analyse le « duel » comme la « stratégie sociale » privilégiée des classes dirigeantes, le vecteur de fabrique de ses habitus. La victoire de 1871 sur la France affermit la conviction selon laquelle seuls les groupes les plus puissants, – c’est-à-dire l’empereur, la société de cour et la noblesse, suivis par les piliers militaires et civils de l’État –, constituait la véritable Allemagne : « la victoire de l’armée allemande sur la France fut en même temps la victoire de la noblesse sur la bourgeoisie en Allemagne.5 » Pour Norbert Élias, - je lui laisse la responsabilité de cette thèse -, cette civilisation belliqueuse de la force et du duel adoptée progressivement par la bourgeoisie allemande fut le prix à payer de son intégration sociale dans les classes dominantes. Et, ce faisant, l’habitus national allemand fut façonné par des usages sociaux de brutalité, de discipline, d’obéissance, de sacrifice et d’héroïsme vantés par les habitus et les codes de l’honneur des aristocraties impériales et militaires. C’est dans les sillons de cette société agonistique que les pratiques et les codes nazis se sont inscrits. De plus, au XXe siècle, la conversion rapide de l’Allemagne à l’économie moderne a facilité l’industrialisation des forces d’anéantissement, le déni d’humanité des victimes, le programme génocidaire, la mort devenant une industrie qui transforme l’humain, le vivant, en matériau, en matière inerte exploitable. C’est la thèse de nombreux sociologues (Georges Friedman, Thérèse Delpech…) à laquelle j’adhère : l’ensauvagement des peuples provient du grand déséquilibre entre leur développement technologique et scientifique et leur « sagesse » pratique. Ce fut un des apports et non des moindres de l’École de Francfort (de Théorie sociale Critique) de considérer que les régimes nazis et fascistes furent la mise à nu de la vérité d’une modernité fécondée par les capitalismes. Nous y sommes confrontés aujourd’hui encore, comme j’essaie de le montrer dans mon dernier essai, Dé-civilisation. Les nouvelles logiques de l’emprise.
Dans tous les cas, je rappelle que la dé-civilisation n’est pas le fait de « sauvageons », de communautés marginales ou d’« enfants-rois », mais appartient de pied en cap à une société de la concurrence par la force, hier militaire, aujourd’hui économique. Si la question d’un « ensauvagement du monde » revient en boucle aujourd’hui, si l’État de droit est menacé, si les relations sociales paraissent de plus en plus brutales, - ou du moins sont « ressenties » comme telles -, ce n'est pas l’invasion d’agents toxiques dans une société saine qui en est la cause, mais plus radicalement la mise à nu de l’essentielle réalité de sa civilisation et d’une hiérarchie des valeurs qui fabriquent les habitus de ses citoyens. Depuis plusieurs décennies l’État français est mis à mal par une technocratie européenne confondant le politique et la gestion des affaires. À cette première confusion du politique et d’une économie, réduite aux acquêts de la gestion des ressources et des profits, s’est ajoutée plus récemment une dégradation constante de la fonction critique du langage par un techno-populisme confondant l’exactitude des faits avec la propagande des publicistes et la communication publicitaire. J’ai montré que les « réalités alternatives » n’étaient pas des accidents médiatiques, mais le paradigme originaire d’une information dont la valeur est réduite aux effets qu’elle produit. C’est de cette civilisation là qu’émergent les tentatives de discréditer l’État de droit, et ce, jusqu’aux néofascismes actuels.
La résurgence de nouvelles formes de fascismes, - que je nomme technofascismes -, surgit dans la niche écologique de sociétés à nouveau en proie à l’angoisse sociale, à l’insécurité, à la crainte d’un chaos entretenue par des « ingénieurs6 » qui y trouvent le moyen de promouvoir leur ordre. L’époque ressemble étrangement à l’Europe de la fin du XIXe siècle et de l’entre-deux Guerres. L’effacement symbolique de la justice au profit de la force d’abord, de la norme ensuite, et aujourd’hui des dispositifs de capture du vivant, détient des conséquences à la fois sociales et psychiques. Je le répète, l’habitus renvoie à la fois aux normes et aux règles du jeu social et à leur intériorisation psychique. L’analyse du psychisme reflète en partie une histoire singulière, mais aussi une histoire collective. Et une sociologie des conduites sociales reflète également les processus par lesquels se façonnent les psychismes dans une société donnée, à une époque donnée.
- 7 Stéphane Zweig, 1943, Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, Paris, le livre de poche, 2014, p. (...)
En conséquence, nos « reculs de civilisation » font partie de l’histoire des processus de civilisation qui ne sont jamais terminés. La dé-civilisation est en permanence au cœur de la civilisation. Stefan Zweig l’écrit avec acuité et puissance : « Nous avons dû donner raison à Freud, quand il ne voyait dans notre culture, qu’une mince couche que peuvent crever à chaque instant les forces destructrices du monde souterrain, nous avons dû nous habituer peu à peu à vivre sans terre ferme sous nos pieds, sans droit, sans liberté, sans sécurité.7 »
Nous observons des évolutions communes dans l’ensemble des États européens sur lesquelles votre réflexion peut nous éclairer :
- D’abord, un repli identitaire, comme le montre l’hostilité affichée à l’égard des étrangers qui abreuve le débat public. Imprégnées de ce nationalisme xénophobe décomplexé, les politiques migratoires rognent progressivement les grands principes – comme le droit du sol – et les garanties les plus élémentaires du droit des étrangers – le droit d’asile par exemple. Quels sont les tenants profonds de ces politiques et les raisons pour lesquelles, malgré l’Histoire, elles continuent d’être activées par les gouvernants ?
Il me semble que dans mon ouvrage Dé-civilisation. Les nouvelles logiques de l’emprise, je propose un début de réponse : cette logique de l’exclusion de l’altérité, de l’extermination (symbolique d’abord, fréquemment réelle ensuite) résulte du mirage récurrent de l’identité nationale. C’est comme s’il fallait maintenir à tout prix l’illusion d’une communauté sans divisions, ni factions, ni inégalités sociales par l’exclusion de bouc-émissaires. C’est toujours la vieille chanson qui berce la misère humaine : « sans eux, nous serions nous.8 » Mais, qui peut croire à de telles balivernes ? Si ce n’est ceux qui ont besoin d’y croire et de croire ceux qui les invitent « à tuer ensemble9 » ou à exclure ensemble. Le rejet ou l’indifférence constituent des formes mineures de la passion triste, de la haine. Mais, pourquoi ? En un mot comme en cent, pour se sentir dignes d’être aimés, pour retrouver une dignité et un narcissisme en cours de naufrage. Cela peut paraître simple, trop simple, et pourtant toute mon expérience clinique l’atteste : le désir d’être reconnu et aimé est primordial, surtout lorsque sa satisfaction est menacée. C’est-à-dire que ce désir d’en finir avec l’altérité est au cœur des « restes » de nazisme logés dans les démocraties. Car, je le répète, le fascisme n’est pas l’invasion d’une idéologie malsaine dans une société saine, il en est l’essentielle réalité moderne. Et, cette réalité essentielle de nos sociétés, nous ne l’avons pas suffisamment reconnue et traitée. Demeurée souterraine pendant plusieurs décennies, elle refait surface aujourd’hui. Theodor Adorno en a eu l’intuition : « Je ne voudrais pas m’attarder sur le problème des organisations néo-nazies. J’estime que la survie du nazisme dans la démocratie présente plus de dangers potentiels que la survie des tendances fascistes dirigées contre la démocratie.10 »
Cette « survie du nazisme dans la démocratie » est bien plus dangereuse que les agitations baroques des nostalgiques du IIIe Reich ou de Mussolini ! Car, cette rémanence du nazisme est liée aux conditions sociales, culturelles et politiques qui, à un moment donné, empêchent d’aimer la démocratie. C’est très précisément au moment où l’organisation sociale ne permet plus la reconnaissance symbolique des individus les uns par les autres, où la multiplicité des points de vue n’apparaît plus comme une richesse mais comme une source de divisions que la cité se disloque et que la guerre devient inévitable. A ce titre la guerre est toujours, d’une certaine manière, une guerre civile étendue aux autres régions du monde. Et, toute guerre civile commence par le bannissement d’une partie de sa société. Comme si l’hétérogène, le composite, le multiple, constituait une menace pour l’identité collective. Il faut qu’elle soit bien fragile cette identité pour exiger l’exil d’une partie d’elle-même, le rejet de l’altérité ou le refus de l’Autre. C’est justement au moment-même où l’identité collective tend à se révéler dans sa caractéristique de « mirage » qu’elle exige des « sacrifices » humains pour y trouver un fondement consistant !
Pour traiter ce problème, il nous faut d’abord répondre à la question de savoir ce qui conduit les humains à s’associer pour créer une cité, c’est-à-dire à construire une cohésion sociale afin de s’épanouir collectivement et singulièrement. Cette question abordée par Aristote, dans son ouvrage majeur, Les politiques11, révèle que les humains font « communauté » non seulement parce que cela leur permet en coopérant et en collaborant matériellement de parvenir à de meilleures productions, à de meilleures fabrications ou services, à survivre, mais encore, - et surtout -, parce qu’ils ont besoin d’une reconnaissance des uns par les autres. Le sujet humain naît « inachevé » et c’est sa vie dans la cité qui permet son épanouissement. Un sujet ne devient humain qu’à partir du moment où il est reconnu comme tel par ses semblables. Pour Aristote, la condition d’homme libre suppose trois traits : l’aptitude à délibérer, la prudence et la capacité de choisir. Or, c’est exactement ces trois conditions de la liberté, à commencer par la liberté de penser, qui se trouve malmenées, altérées et parfois empêchées dans la réalité essentielle des sociétés modernes. Et, le drame précisément de l’émergence des fascismes résulte de leur tendance à prospérer sur les ruines des conditions sociales et civilisationnelles de la capacité de penser. D’où ce pessimisme qui nous fait envisager les résurgences possibles des fascismes dans une Europe moralement déprimée et socialement exposée à la désintégration culturelle. A ce moment-là, le désir d’être reconnu est d’autant plus exigeant et puissant dans certaines périodes de notre histoire que les individus sont isolés, désolés, démunis, dénutris.
- 12 Theodor W. Adorno (1963), Modèles critiques,Paris, Payot, 2003, p. 118-119.
Dans ces périodes de désolation et d’incertitude extrêmes la tentation est grande de s’agripper à un leader, à son système et à ses mensonges, à son déni des réalités blessantes. Et, pour sortir de la désolation des ermites de masse qui précède la résurgence des fascismes, il faut « rester entre nous » et « agir ensemble » jusqu’au crime. Le crime collectif est aussi un moyen d’initiation sociale dans ces périodes troublées où l’effacement de l’empathie constitue un des premiers symptômes de l’émergence de tels régimes (Hannah Arendt). Tous ceux qui ont travaillé les documents historiques de ces périodes le savent : le désir d’être aimé, reconnu, identifié, joue à pleins tuyaux dans ces moments d’hypnose collective. Par exemple, Theodor Adorno démonte l’illusion selon laquelle le régime national-socialiste n’aurait signifié que craintes et souffrances pour des populations auxquelles il aurait été imposé. Il écrit : « l’intégration si souvent mise en avant, l’organisation de plus en plus concentrée du réseau social qui englobait tout, assuraient également une protection contre la crainte universelle de tomber à travers les mailles et de sombrer. Ils étaient innombrables ceux qui se croyaient débarrassés du froid de l’aliénation sociale grâce à la chaleur du côte à côte, même manipulée et suscitée artificiellement.12 » Cette question identitaire ne se pose-t-elle pas plus que jamais aujourd’hui dans un monde où le désir d’être aimé et reconnu est obturé par une civilisation des mœurs où prévalent la concurrence à mort, les rapports de force, la désolation sociale et l’extrême solitude d’humains exposés à leur vulnérabilité sans autre partage que les connexions algorithmiques dévitalisées et décharnées.
Alors que la République française a été pensée à partir d’un équilibre plutôt libéral entre le maintien de l’ordre public et la protection des libertés13, on voit gonfler les impératifs de sécurité au profit d’un encadrement toujours plus strict de l’exercice de nos libertés. Au-delà du cadre juridique des états d’urgence pour lesquels la menace terroriste ou sanitaire a justifié un recul de nos libertés individuelles et collectives, cette évolution se poursuit en période « normale » avec notamment une surveillance renforcée de l’espace public, un élargissement du champ pénal ou une multiplication des sanctions administratives contre l’expression des libertés collectives :liberté de manifestation14, de réunion ou d’association15. En France, ironie sémantique, cet arsenal sécuritaire intègre le champ dit de la « sécurité intérieure » – comme le code du même nom depuis 2012. Présentée – au prix d’un contresens largement diffusé par la droite16– comme « la première des libertés », la sécurité devient la priorité des citoyen.nes qui, en son nom, acceptent les dispositifs les plus répressifs. Il est sans doute pourtant peu probable que ceux-ci nous ouvrent la voie de la sécurité intérieure… Que vous inspire ce ralliement collectif à un État sécuritaire17 ?
Pour répondre à cette question que je viens en partie de traiter, je dirais qu’au mirage identitaire répond souvent l’exigence d’un État « sécuritaire ». C’est justement dans les périodes de crise, d’angoisse sociale, d’incertitude, de craintes de chaos que surgit l’appel à la sécurité hobbesienne. La peur est l’affect politique par excellence qui devient le moyen d’en finir avec nos libertés.
Vous le savez, Thomas Hobbes18, au XVIIe siècle, avait élevé la peur, émotion morale, à la dignité d’une passion utilitaire commune (la peur de la mort), à l’origine des religions et des États. La crainte d’une guerre de tous contre tous rendrait souhaitable un pouvoir centralisé et absolu capable de maintenir la paix et d’empêcher un retour à l’état de nature. L’État, tel le Léviathan de la Bible, serait en charge pour Hobbes de confisquer la violence de chacun pour le bien de tous. La peur détiendrait de ce fait une valeur de discipline au cœur des manières d’éduquer et de transmettre la civilisation. De l’aveu même de Hobbes, la peur prend une valeur contre-révolutionnaire faisant du souverain absolu et centralisateur le rempart contre le chaos social. Ce modèle à jamais indispensable au pouvoir « sécuritaire » est devenu le paradigme récurrent de toutes les autorités qui réclament une soumission aveugle, mais librement consentie : « confiez-moi votre force et votre agressivité, et je vous garantirai la sécurité ». Dans les temps modernes, ce paradigme peut prendre le visage des populismes pour justifier l’ordre tyrannique. A la manière du fascisme mussolinien le tyran peut affirmer : « je suis le peuple » et son corollaire, « le peuple, c’est moi.19 » Simplement, comme le rappelle Hobbes, l’État n’est rien sans les fictions qui fabriquent les peurs.
Le Léviathan tout seul ne saurait obtenir l’adhésion des citoyens. Pour que ça marche, encore faut-il que les citoyens fictionnent, qu’ils fictionnent non seulement la force du pouvoir auquel ils consentent de se soumettre, mais aussi qu’ils fictionnent les sources de ce qui leur fait peur. Les humains fictionnent et ont peur de leurs fictions qu’ils prennent pour des réalités. Le pouvoir de l’État repose, en partie du moins, sur des fictions que les individus créent pour donner un motif à leur peur. Ce n’est donc pas sur le sécuritaire qu’un pouvoir peut légitimement fonder son autorité et exiger l’adhésion du citoyen. La chose est évidente, mais dans les périodes de transition et de troubles, l’image est, en particulier chez les ministres de l’intérieur, rémanente… Or, si vous acceptez d’abandonner la peur comme fondement de la sécurité, celle-ci ne devient pas seulement une affaire sécuritaire assurée par un pouvoir régalien. Elle est donnée aussi par le soin, l’éducation, la culture, l’être-ensemble. Ensemble, on a moins peur quand on partage le sensible par la parole ! C’est lorsque les conditions sociales et culturelles du vivre-ensemble, - par les soins réciproques de notre vulnérabilité spécifique -, deviennent faméliques que la peur resurgit et avec elle les pouvoirs tyranniques.
Alors que le néolibéralisme présente le progrès technique et ses avatars – standardisation, expertise, évaluation, numérisation… – comme une autre des réponses idoines à nos peurs, vous alertez au contraire contre la logique d’aliénation qu’il sous-tend. Pourtant, au-delà des individus, c’est l’État lui-même qui se soumet à cette logique, comme en atteste l’externalisation d’activités régaliennes ou même, plus indirectement, la numérisation des services publics et l’ « algorithmisation » des décisions administratives. Le ralliement toujours plus soutenu de la puissance publique au néolibéralisme conduit à la fragilisation du contrat social : L’État est-il encore pour vous la solution du contrat social ?
La réponse pourrait occuper un ouvrage entier. Ce que plusieurs d’entre nous ont déjà fait. Je dirai simplement : la spécificité du néolibéralisme est le principe cardinal de la concurrence sur lequel il fonde toutes les activités sociales. À partir de ce moment-là, l’État lui-même épouse les modèles, les habitus, les valeurs, les pratiques des marchés. Il contraint ses services publics à adopter des visions du monde et des pratiques issues des logiques des marchés. Il contraint les individus à devenir des auto-entrepreneurs de leurs propres existences, des micro-entreprises en charge de gérer leurs capitaux bio-psycho-sociologiques. Il change radicalement de nature, il n’est plus médiateur des conflits entre les classes sociales, créateur d’espaces dialogiques de délibération pour traiter les divisions de la nation. Il devient partisan en se mettant au service des logiques de domination sociale et économique. Je ne peux, en aucune manière, accorder du crédit à un tel État pour refonder du lien social, pour rétablir la démocratie et restaurer la vertu politique de la parole. C'est donc la nature de cet État qu’il faudrait changer pacifiquement et culturellement. Et de ce point de vue, j’accorde une importance toute particulière aux collectifs de professionnels et de citoyens qui s’efforcent de défendre les métiers de l’humain, comme celui du soin, de l’éducation, de la justice, de l’information, de la culture, de l’aide. Il s’agit de ne plus laisser la priorité à la rationalité logistique sur la finalité des métiers, et en finir avec ces dispositifs de servitude que sont les évaluations actuelles par des indicateurs quantitatifs de performance. Et de ce fait, modifier indirectement la nature d’un État qui a perdu sa légitimité suprême en restaurant la vertu de la délibération pour régler les conflits et rétablir la priorité du vivant sur l’argent et ses équivalents abstraits.
Si vous décrivez une dépossession du politique et une désolation sociale qui s’installe et nous conduit au chaos, votre pensée n’est pas pour autant pessimiste. Vous voyez le chaos comme une occasion de faire acte de création pour repenser la société. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?
Oui, nous sommes dans un moment de crise. Et, la crise, comme le disait Gramsci, c’est quand « le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à naître, et dans ce clair-obscur naissent les monstres. » Les monstres, aujourd’hui, ce sont les régimes illibéraux et les technofascismes que l’on voit émerger des ruines des néolibéralismes. Nous craignons l’apocalypse, - qui signifie étymologiquement « révélation » -, mais d’une certaine manière elle a déjà eu lieu. Les « cartes » sont sur la table : face à une crise anthropologique majeure, il y a ceux qui croient à la technique comme solution à tous nos problèmes (jusqu’au transhumanisme) et ceux qui croient dans l’humanisme (le vivant devenant la mesure de toute chose). Ceux qui croient dans le pouvoir de la force pour produire, quelle qu’en soit la modalité, et ceux qui croient dans la puissance de la vulnérabilité pour créer. Il y a les ingénieurs et il y a les poètes, les comptables et les artistes.
Que l’on me comprenne bien : je ne parle pas de la technique comme outil, mais comme environnement ontologique, un environnement donateur du monde. Et, je ne parle pas non plus de cet humanisme tiède qui a longtemps confondu les valeurs de justice et celles de charité. Non, je parle d’un humanisme de combat fondé sur les notions de dette et de solidarité, révisant les principes germinaux mais restrictifs des courants de la fin du XIXe siècle. Non un faux universel des Lumières occidentales, mais un « diversel » comme l’ont proposé Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau. Une solidarité des vivants avec tout le vivant, actant le décès d’une maîtrise par les hommes d’une nature dont ils feignent d’oublier qu’ils lui appartiennent.
C’est précisément sur ces choix à faire que la crise appelle une décision, encore l’étymologie. Comment on rend vivable, humain, un environnement façonné, donné par la technique, - c’est-à-dire l’ensemble du système technicien, comme disait Jacques Ellul, technique dont nous ne pouvons pas nous passer, c’est évident ? Comment rendre vivantes nos relations aux objets techniques, les faire solidaires des rapports au vivant ? Car, c’est bien de relations dont il s’agit, et non pas d’objets ou de sujets. C’est précisément-là que s’ouvre la voie spécifique du politique, entre l’ingénieur et le poète, entre le vivant et la technique elle doit tracer un chemin vers l’imaginaire pour atteindre le réel, et nous permettre de « dépasser la négativité du monde par le désespoir de notre imagination20 ». Les nouvelles technologies nous y invitent plus qu’on ne le dit, et nous y parviendrons à la condition de les déconnecter des pouvoirs et des logiques des dominants et autres oligarques. Un énorme chantier, un prochain champ de guerre culturelle.
Notes
1 http://www.appeldesappels.org
2 V. par ex. Serge Slama, « Une remise en cause de l’État de droit désormais assumée », in Dossier, État de droit : fragilisation inquiétante, Droit et libertés, N° 207, octobre 2024, p. 44. Egal. Jacques Chevallier, « L’État de droit controversé », La Revue des droits de l’homme[En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 03 juin 2024.
3 Norbert Elias, 1939, La Civilisation des mœurs. Paris, Calmann-Lévy, 1973 ; Norbert Elias, 1969, La Dynamique de l’Occident. Paris, Calmann-Lévy, 1977.
4 Nous avons commencé à nous y référer avec Marie-José Del Volgo dès Éxilés de l’intime publié en 2008 chez Denoël et actuellement disponible dans la collection Poche de LLL depuis 2020.
5 Norbert Élias, 1989, op. cit. p.28.
6 Giuliano da Empoli, Les ingénieurs du chaos (2019), Paris, Gallimard, 2023.
7 Stéphane Zweig, 1943, Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, Paris, le livre de poche, 2014, p. 19.
8 Thierry Fabre, Faut-il brûler Averroès ? Paris, Riveneuve, 2025.
9 Antonio Scurati, 2018, M L’enfant du siècle, Paris, Les Arènes/ Collection Poche, 2023, p. 416.
10 Theodor W. Adorno, 1963, Modèles critiques, Paris, Payot, 2003, p. 112.
11 Aristote, Les politiques, Paris, Flammarion, 1990.
12 Theodor W. Adorno (1963), Modèles critiques,Paris, Payot, 2003, p. 118-119.
13 Selon la célèbre formule du commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917 : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception ».
14 Avec par exemple le déploiement de techniques d’encadrement dissuasive comme la « nasse » et l’augmentation du nombre d’interdiction de manifestation ou le fichage de manifestants – V. sur ces deux points Yannis Benrabah, Capucine Blouet, Vincent Louis et Nathalie Tehio, « La nasse : un dispositif de maintien de l’ordre toujours non encadré par le Conseil constitutionnel » et « La pratique de la nasse au regard du droit européen des droits de l’Homme », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 24 mai 2021 ; Yoann Nabat, “Ficher les manifestants : entre sauvegarde de l’ordre public et risques de répression politique”, La Revue des droits de l’homme [Online], 27 | 2025, Online
15 Avec un renforcement des conditions de constitution et de financement des associations et une pratique record des dissolutions administratives ces dernières années. V. par ex. Jeanne de Gliniasty, « L’annulation de la dissolution des Soulèvements de la Terre : quand la cause environnementale sert aussi celle du Conseil d’État », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 08 janvier 20. Pour information, à l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1936, le Centre de Recherche et d’Études sur les droits fondamentaux organise le 13 janvier 2026 une journée d’étude consacrée aux libertés associatives.
16 https://www.liberation.fr/france/2013/09/24/la-securite-premiere-des-libertes-histoire-d-une-formule_934227/
17 Pour reprendre l’expression de Jacques Chevallier, « L’État de droit au défi de l’État sécuritaire », in Le droit malgré tout, édité par Yves Cartuyvels et al., Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2018.
18 Thomas Hobbes, 1651, Léviathan, Paris, Folio, 2000.
19 Antonio Scurati, La politique de la peur, p. 62, Paris, 2024.
20 Walter Benjamin, « Lettre à Gershom Scholem du 17 avril 1931 » cité in Hannah Arendt, Vies politiques (1955), Paris, Gallimard, 1974, p. 268.
- A lire sur Mediapart. Après quatre mois de grève, le mouvement étudiant s’est transformé. Avant la rentrée universitaire de la mi-août, ses animateurs veulent mobiliser tout l'été. Et il est de plus en plus question d'élections anticipées...
- Par PIERRE JOLY Psychothérapeute à la Maison Saint-Jacques, Montréal Article paru dans Libération du 11 juin. Les étudiants québécois s’opposent au gouvernement libéral de Jean Charest qui a décrété une hausse de 75% (en cinq ans) des...
Le nouveau monde et la crise des valeurs. Manifeste de soutien aux étudiants et collègues québécois.
Pour les plus anciens d’entre nous, l’insurrection étudiante au Québec réveille de bien vieux souvenirs. Comparaison n’est pas raison. Il n’empêche.
Par Roland Gori, à lire dans Libération
- Par Roland Gori, article paru dans le journal l'humanité du 22 février 2012
- Emission de Catherine Parisot sur Fréquence protestante avec Roland Gori, psychanalyste : "Contre la tyrannie des experts : la liberté de penser"
- On a beaucoup parlé cette semaine d'agences de notation, de dégradation de notes, de crise de l'Europe et ...de gros sous. Mais comment construire un monde différent, comment le penser quand les chiffres et les notations nous imposent leur loi... Une...
Copyright © 2011 L'Appel des appels | Tous droits réservés - Contact