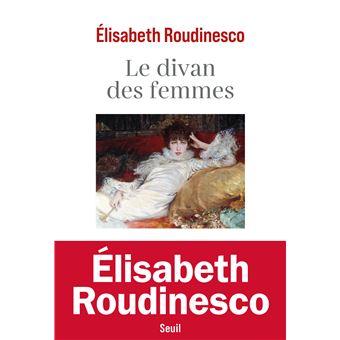Soutenez l'Appel des Appels
- De quoi la « dé-civilisation » est-elle le nom ? Un éloge réparateur et humaniste de la création envisagée en tant que lutte sociale et politique pour l’émancipation des êtres humains.
- Dans nos sociétés de contrôle, l’information est le moyen privilégié de surveiller, de normaliser et de donner des ordres. Les informations, molécules de la vie sociale, deviennent les sujets de...
- Il fallait à notre pays un certain culot pour élire à la magistrature suprême un jeune homme quasiment inconnu, négociateur habile du compromis autant que «traître» méthodique. Emmanuel Macron...
- Dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Ils naissent du vide culturel d’un monde politique sans esprit, d’un monde où les techniques sont devenues folles, d’un monde qui...
«L’école condamnée à produire du capital humain»
Article publié dans le journal Libération.
Interview. A la botte de l'économie, le système scolaire se serait lancé dans une course à la compétitivité. Une mutation que déplore le sociologue Christian Laval, dénonçant le déclin de la pédagogie et un surcroît d'inégalités.
Par Véronique Soulé.
Suppressions de postes, résultats des élèves en baisse, enseignants désorientés… L’éducation sera l’un des sujets de la campagne présidentielle et la Nouvelle Ecole capitaliste - le livre de Christian Laval (1), Francis Vergne, Pierre Clément et Guy Dreux - tombe à point pour le nourrir. Les auteurs, enseignants et chercheurs, analysent les transformations en profondeur entraînées par le néolibéralisme dans le système éducatif. Christian Laval, professeur de sociologie à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, revient sur les mécanismes ayant conduit à une redéfinition des missions de l’école au service de l’entreprise et plaide pour un renouvellement de la pensée sociologique.
Vous décrivez une «nouvelle école capitaliste» soumise à la concurrence, gérée comme le privé et au service de l’économie : est-elle née sous Sarkozy ?
Non, ce serait une grande erreur de le croire. Le sarkozysme a accéléré et rendu plus visibles les transformations néolibérales ou, pour appeler un chat un chat, la mutation capitaliste de l’école. Mais elles étaient amorcées depuis longtemps en France et à l’étranger. Le programme de transformation de l’université française a ainsi été ébauché à la fin des années 90, puis a commencé à s’appliquer au début des années 2000, avant d’être parachevé avec l’arrivée de Nicolas Sarkozy et la loi sur l’autonomie des universités [la LRU, votée en août 2007, qui avait suscité un vaste mouvement de protestations, ndlr]. Bien au-delà de la finance et des marchés de biens et services, le néolibéralisme a progressivement touché toutes les institutions, y compris l’école, notamment avec l’apparition du nouveau management public, c’est-à-dire avec l’importation des techniques managériales du privé dans les services publics.
Vous dénoncez la concurrence qui a gagné l’école, les compétences qui ont remplacé les connaissances et l’obsession de l’employabilité : ce sont les caractéristiques de l’«école capitaliste» ?
Oui, c’en sont des aspects majeurs. D’abord, les missions de l’école et de l’université ont été progressivement redéfinies. Les systèmes éducatifs ont été sommés de justifier les dépenses qu’on leur consacre par un «retour sur investissement» de nature économique. Cela devient la préoccupation exclusive de cette nouvelle école : elle est au service de l’économie et doit s’intégrer à la course à la compétitivité et à la productivité. Logiquement, elle doit donc s’organiser selon le principe de la concurrence et faire sien l’impératif de «performance». Ces nouvelles dimensions sont progressivement devenues une norme évidente, une sorte de rationalité incontestable qui a conquis les esprits. Experts, administrateurs, responsables politiques, certains syndicats minoritaires ont même vu dans cette adaptation au monde moderne la solution à tous les maux de l’école. Ces transformations ont touché au cœur du métier enseignant. Elles ont entamé profondément un système de valeurs partagées, l’idée ancrée chez les enseignants que leurs missions dépassent le cadre d’un métier ordinaire, leur sens de l’intérêt général… Ils ont eu l’impression d’être dépossédés de leur métier par un flot torrentiel des réformes.
Le concept d’employabilité est au cœur de vos critiques : pourquoi ?
Dans le discours des institutions internationales et de plus en plus dans celui des responsables nationaux, l’école a pour fonction de produire des ressources humaines ou du «capital humain». L’employabilité est devenue la norme qui organise les mutations de l’école. L’idéologie de la professionnalisation a pénétré l’université et l’ensemble du système, jusqu’aux premiers niveaux de l’enseignement. Prenons le «socle commun de compétences» [introduit au collège puis en primaire, il liste les aptitudes que l’élève doit acquérir, à côté des connaissances]. Ces compétences ont été fixées par l’OCDE et par la Commission européenne à partir de critères d’employabilité, en fonction de considérations économiques et non pas pédagogiques. On va jusqu’à redéfinir les programmes, l’évaluation, la pédagogie.
Mais est-ce critiquable que les jeunes veuillent des débouchés à la fin de leurs études ?
Certes non, et ce n’est pas nouveau. L’école républicaine avait idéalement trois missions - former l’homme, le citoyen et le travailleur. Il est normal que dans une économie où près de 95% de la population ne dispose pas de ses propres outils de travail, le souci de l’insertion professionnelle soit constant, surtout en période de chômage important des jeunes. Mais nous tombons dans un écueil : celui de réduire la mission de l’école et de l’université aux débouchés professionnels, à partir d’une définition utilitariste des contenus d’enseignement. Or, une solide formation intellectuelle ne nuit pas à l’emploi, bien au contraire. Mais avec la logique des compétences, on définit ce qu’il faut acquérir aux différents âges en vue de l’employabilité à 16 ans. Comme si les usages de la force de travail par les employeurs devaient imposer à l’école ce qu’elle devait transmettre. Ce sont les économistes, notamment ceux des institutions internationales, qui définissent les fonctions et les missions de l’école. Il s’agit là d’une rupture majeure.
Comment ces changements conduisent-ils au creusement des inégalités constaté aujourd’hui ?
Avec le consensus ambiant, il paraît normal à beaucoup que les établissements doivent être en concurrence, attirer les meilleurs élèves et étudiants, faire de la publicité pour leurs formations, trouver le plus d’argent possible. Or, tout cela a des effets inégalitaires et conduit à une polarisation sociale des établissements, de plus en plus assumée dans le supérieur et de plus en plus évidente dans le primaire et le secondaire.
Ces changements - la concurrence généralisée et la transformation entrepreneuriale du système - ont accentué et renouvelé les mécanismes de la reproduction sociale en donnant à l’argent et aux réseaux familiaux un poids grandissant. Les classes favorisées assurent leur reproduction plus efficacement qu’avant. Ce ne sont plus les voies nobles de l’élitisme républicain - comme l’Ecole normale supérieure - qu’elles privilégient. Ce sont désormais HEC et les écoles commerciales qui attirent les meilleurs élèves, y compris dans les filières littéraires. Nous vivons la grande revanche de l’argent sur la culture.
Depuis vingt ans, les politiques éducatives d’inspiration néolibérale ont ainsi aggravé les inégalités comme le montre le recul de la part des enfants des classes populaires à l’université. La concurrence entre établissements et la libéralisation de la carte scolaire ont encouragé l’apartheid scolaire. Rappelons que les deux finalistes, de droite et de gauche, à la présidentielle de 2007 [Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal] étaient favorables à la suppression ou, au moins, à un très grand assouplissement de la carte scolaire.
La gauche ne se distinguerait pas de la droite ?
Ces vingt ou trente dernières années, le néolibéralisme s’est imposé comme une norme aux gouvernements de droite comme de gauche. La droite a été la plus agressive dans la réforme néolibérale, jusqu’à affaiblir aujourd’hui gravement le système éducatif. La gauche au pouvoir n’a jamais remis en question le nouveau modèle managérial et concurrentiel, bien au contraire. Elle n’a pas voulu comprendre que la transformation des systèmes publics par les principes du management était l’une des formes de déploiement du capitalisme contemporain. Celui-ci ne se contente pas de déréguler les marchés de biens, du travail et des capitaux. Il transforme aussi l’action publique. Il la «met en marché», c’est-à-dire y impose la logique de la concurrence et le modèle de l’entreprise. Cette «marketization», comme disent les anglo-saxons, est aujourd’hui le cœur de la transformation de l’école et de l’université.
Il n’y a donc pas de vision alternative de l’école à gauche…
La pensée de la gauche dite de gouvernement s’est effondrée en matière d’éducation. Il suffit de regarder ce que propose le PS pour s’en apercevoir. La question d’un projet alternatif se pose avec urgence aux partis, aux syndicats et aux associations. Depuis les années 80, on assiste à un morcellement des réflexions et à une profonde dépolitisation de la question scolaire. Les considérations se sont technicisées. Elles portent sur l’organisation scolaire et la pédagogie sans plus aucune référence à un projet d’émancipation. Dans ses plus grands moments - il suffit de penser à Jaurès -, la pensée progressiste sur l’éducation avait construit un projet de transformation en articulant une vision de la société, une mission pour l’école, une définition du métier enseignant et une orientation de la pédagogie.
Comment voyez-vous «l’école post-capitaliste» que vous appelez de vos vœux ?
Vaste chantier. Qu’est-ce qu’une école démocratique ? Premièrement, c’est une école qui réduit les inégalités entre les enfants des différentes classes sociales. Mais elle ne peut le faire qu’en étant partie prenante d’un grand mouvement de réduction des inégalités dans toute la société. Jaurès disait en substance : «Nous ne ferons pas l’école socialiste au milieu de l’océan du capitalisme.» C’est encore vrai. Une école démocratique ne pourra vraiment se développer que dans une société où l’égalité sera promue comme valeur essentielle.
Mais comment faire plus d’égalité?
Tout est revoir sous cet angle : les méthodes d’enseignement, les contenus, l’articulation des niveaux d’enseignement, la mixité scolaire des établissements. Deuxièmement : dans la perspective d’une telle société démocratique, l’école doit former des individus ayant des outils communs de compréhension du monde, en particulier sur le plan social et économique. Elle doit leur fournir des instruments de jugement moral et politique qui leur permettent d’être les citoyens de «la démocratie réelle», selon l’expression des Indignés. La lutte contre les inégalités sociales et économiques est inséparable de la lutte pour la démocratie politique effective. Cela suppose une société où le capitalisme ne régnerait pas en maître absolu comme aujourd’hui.
Vous ne seriez pas un peu nostalgique de l’ancienne école ?
En aucune façon. On taxe toujours un peu vite de passéistes les gens qui critiquent les réformes, ou plutôt les contre-réformes actuelles pour mieux justifier son propre aveuglement ou sa soumission à l’ordre néolibéral. Il s’agit pour nous d’échapper au débat stéréotypé entre les «pédagogues» supposés modernes et les «républicains» que l’on dit nostalgiques d’un âge d’or de l’école. La réinvention de l’école démocratique mérite mieux qu’un retour à de vieux conflits.
(1) Il a aussi signé la préface de «l’Ecole en Europe, politiques néolibérales et résistances collectives», sous la direction de Ken Jones, La Dispute, 2011.
- Albert Ciccone est professeur émérite de psychopathologie et psychologie clinique (université Lumière-Lyon 2), psychologue, psychanalyste, président de la Convergence des Psychologues en Lutte (CPL) et de l’Association Lyonnaise pour une Psychanalyse À partir...
- Alors que la presse générale n'a de cesse de concentrer ses analyses sur la question du nombre trop important de fonctionnaires ou l'efficacité du service public, à la faveur des échéances électorales, Christelle Mazza décrit, sans filtre, les...
- À paraître le 06/03/2026 Rencontre à la librairie Compagnie (Paris), à 20h, avec Elisabeth Roudonesco autour de son livre, Le Divan des femmes.
- Jeudi 19 février 20h30 au ciéman Les Trois Luxembourg Séance spéciale du film ROLAND GORI, UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT de Xavier Gayan, en présence de Roland Gori, Alian Vanier et Xavier Gayan Plus d'information sur le site des Trois Luxembourg
- A lire sur Mediapart. Après quatre mois de grève, le mouvement étudiant s’est transformé. Avant la rentrée universitaire de la mi-août, ses animateurs veulent mobiliser tout l'été. Et il est de plus en plus question d'élections anticipées...
- Par PIERRE JOLY Psychothérapeute à la Maison Saint-Jacques, Montréal Article paru dans Libération du 11 juin. Les étudiants québécois s’opposent au gouvernement libéral de Jean Charest qui a décrété une hausse de 75% (en cinq ans) des...
Le nouveau monde et la crise des valeurs. Manifeste de soutien aux étudiants et collègues québécois.
Pour les plus anciens d’entre nous, l’insurrection étudiante au Québec réveille de bien vieux souvenirs. Comparaison n’est pas raison. Il n’empêche.
Copyright © 2011 L'Appel des appels | Tous droits réservés - Contact